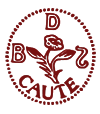Dans l'histoire de la philosophie, les philosophes n'ont pas ménagé les femmes. Spinoza échappe-t-il à la règle ?

Madeleine Francès, avec sa traduction du Traité théologico-politique conclut à partir d'une citation du chapitre 13 à l'antiféminisme de Spinoza (n. 1 de la page 800, Pléïade) : ''Hommes, femmes, enfants ont une égale aptitude à obéir, mais non à pratiquer la sagesse". M. Francès déduit de cette phrase que pour Spinoza, femmes et enfants sont inférieures à l'homme. Alors que le contexte montre bien pourtant que la proposition s'applique indistinctement à tous, hommes comme femmes, comme enfants. Tous les hommes n'ont pas la même capacité à pratiquer la sagesse, les femmes et les enfants de même.
Madeleine Francès lit dans la philosophie de l’Éthique que 'femmes et enfants sont livrés à des instincts aveugles' mais Spinoza en dit de même des hommes. Ensuite elle croit voir que femmes et enfants 'ignorent la vie intellectuelle et morale', je ne sais pas où elle a vu cela. Ce serait contradictoire avec le chapitre XX de l'appendice de la partie IV : "Quant au mariage, il est certain qu'il est d'accord avec la raison, à condition que le désir d'unir les corps ne vienne pas seulement de la forme, mais qu'il soit accompagné du désir d'avoir des enfants et de les élever dans la sagesse. J'ajoute encore cette condition, que l'amour de l'homme et de la femme ait sa cause principale, non dans la forme, mais dans la liberté de l'âme." Comment la femme pourrait-elle participer à l'éducation des enfants dans la ''sagesse'' si elle-même n'avait pas la moindre sagesse ? Comment pourrait-elle apprécier la liberté de l'homme si elle ne participait pas elle-même à cette liberté ?
Sur les jugements généraux que bien des philosophes se sont plus à formuler sur les femmes, Spinoza ne peut que les rapporter à des idées inadéquates dans son Éthique : ''De même encore celui qui a été mal reçu par sa maîtresse n'a plus l'âme remplie que de l'inconstance des femmes, de leurs trahisons et de tous les défauts qu'on ne cesse de leur imputer ; mais revient-il chez sa maîtresse et en est-il bien reçu, tout cela est oublié.''1 Cela n'est pas sans faire penser à la prop. 46 d’Éthique III où Spinoza montre le mécanisme d'association inadéquate d'idées par lequel fonctionne le racisme. Ce qu'il dit à propos du ''groupe social'' ou de la ''nation'' peut tout aussi bien s'appliquer au sexe.
Mais venons en au Traité Politique qui contient les propositions les plus négatives au sujet des femmes. Il faut d'abord se remémorer qu'en ce Traité, Spinoza se donne pour but de penser à quelles conditions un régime politique peut être stable. Pour cela, le principal obstacle à surmonter est selon lui la tentation de fonder un tel régime sur la base d'une représentation idéale de la nature humaine, qui n'est que chimère et Utopie inapplicable2. Le philosophe entend alors se fonder uniquement sur l'expérience pour ce qui est de trouver les moyens les plus efficaces de tenir la multitude ''en bride''3, en d'autres termes pour qu'une paix et une sécurité réelles (et non simplement apparente comme dans certains régimes dictatoriaux : TP V, 4) perdurent. Bien que Spinoza s'efforce de cette façon de rester aussi impartial dans le domaine politique que dans le domaine mathématique (TP I,4), l'empirisme sur lequel il fonde son étude du politique risque fort l'amener à des généralisations abusives.
En effet, dans le paragraphe 4 du chapitre XI sur la démocratie, Spinoza se propose de montrer pourquoi les femmes doivent être exclues de tout gouvernement sur la base des ''leçons de l'expérience''. Or l'expérience de Spinoza, au XVII° siècle, c'est que jamais les hommes et les femmes n'ont partagé le pouvoir politique de façon paisible. Dans les Etats qui ont connu de longues périodes de paix, les femmes sont dominées. Si l'on prête foi à la légende des Amazones, elles régnèrent également à l'exclusion des hommes, mais ne pouvant le faire qu'en tuant les mâles à la naissance. On trouve là sous la plume de Spinoza une phrase malheureuse : "Si les femmes étaient, de par la nature, les égales des hommes, si, en force de caractère et intelligence (constituants essentiels de la puissance, et par conséquent, du droit des humains) les femmes se distinguaient au même degré que les hommes, l'expérience politique le proclamerait bien !". L'expérience ici sert de preuve alors qu'elle n'est pas ce qui rend nécessaire l'idée d'une infériorité féminine mais plutôt sa conséquence : à partir du moment où elles sont élevées dans le préjugé général de leur infériorité intellectuelle et morale, il est logique qu'elles soient mises à l'écart des fonctions politiques. Mais cela ne prouve en aucun cas que bénéficiant d'une éducation égale à celle des hommes, les femmes ne pourraient pas se révéler aussi valables, voire parfois supérieures aux hommes en intelligence et en force de caractère. Spinoza envisage la possibilité d'un État où "les femmes gouverneraient les hommes et les feraient éduquer, de telle manière que leur intelligence ne se développât point" mais il ne semble pas lui venir à l'esprit qu'il peut en être de même en ce qui concerne l'éducation des femmes à son époque.
L'idée de Spinoza est que s'il était possible que les femmes se révèlent égales aux hommes, l'expérience aurait déjà révélé des cas d'égalité entre hommes et femmes sur le plan politique. Ce que néglige ici Spinoza, ce sont certains principes de sa philosophie même : la connaissance par expérience dont il parle ici est vague et relève du premier genre de connaissance, inadéquat et partiel. Il peut donc y avoir eu avant le XVII° s. des cas où les femmes ont été éduquées dans l'égalité avec les hommes. Un cas semble négligé : le statut des femmes dans la cité de Spartes au VIII° siècle av. J.-C.. Selon la constitution de Lycurgue, les femmes étaient associées au service de l’État. Elles étaient élevées aussi durement que les hommes, entraînées au combat et éduquées comme eux. En outre, "nul ne sait ce que peut le corps" ou selon une autre traduction "personne n'a déterminé ce dont le corps est capable" (E3P2S) : l’expérience ici n'est pas d'un secours définitif. En effet les corps sont si complexes qu'on ne peut de façon définitive se prononcer sur ce qu'ils peuvent faire et ne peuvent pas faire. S'il en est ainsi du corps individuel, a fortiori en est-il du corps politique, composé d'une multitude de corps humains.
Après s'être appuyé sur l'expérience, Spinoza propose de comprendre les raisons de cette supposée inégalité des femmes par rapport aux hommes sur le plan politique : "les hommes, on le sait, n'aiment le plus souvent les femmes que d'un désir sensuel ; ils n'apprécient leur intelligence et leur sagesse, qu'autant qu'elles sont belles. D'autre part, les hommes supportent très mal que les femmes qu'ils aiment accordent la moindre marque d'intérêt à d'autres hommes ; et ainsi de suite... Dès lors, nous voyons sans peine que, si les hommes et les femmes assumaient ensemble l'autorité politique, la paix aurait beaucoup à souffrir de cette probabilité permanente de conflits". Si donc l'expérience, au temps de Spinoza, n'a jamais montré de cas d'égalité politique entre les sexes, ce qu'on voit sans peine, c'est que c'est à cause des hommes et de leur aveuglement sur les femmes.
Mais quand bien même on considèrerait cet aveuglement comme indépassable par les hommes, il est bien noté que la préférence pour les belles femmes n'empêche pas de considérer également leur intelligence et leur sagesse pour ce qui serait de leur confier des fonctions politiques. En outre, puisque nous sommes dans le chapitre sur la démocratie, confier la souverainté politique à tout le peuple, y compris les femmes, permet naturellement de contre balancer une éventuelle stupidité des hommes à ne choisir pour les représenter que de ravissantes idiotes.
En ce qui concerne la jalousie, je vois mal exactement de quoi Spinoza veut parler. S'agit-il de la jalousie que pourraient avoir entre eux les hommes politiques au sujet d'éventuelles femmes politiques ? Mais que des femmes accèdent à des fonctions politiques n'implique pas qu'elles soient forcément mariées à d'autres hommes politiques. Et quand bien même, pour que cela soit une véritable cause de discorde systématique, il faudrait que les hommes soient stupides au point de ne pouvoir contrôler aucun penchant à la vue d'une femme. Or si tel était le cas, ce n'est pas interdire aux femmes les fonctions politiques qui serait nécessaire, mais leur interdire purement et simplement de jamais se montrer aux hommes. Comme des sociétés où le voile pour les femmes n'est pas obligatoire peuvent subsister, même au temps de Spinoza, notamment grâce à des lois et à une force civile qui les font respecter, il n'y a aucune raison sérieuse d'interdire aux femmes les fonctions politiques.
Je dirai pour conclure qu'en ce qui concerne les femmes, Spinoza a fait preuve de précipitation dans le jugement, peut-être une des seules fois dans sa philosophie. En leur refusant l'égalité politique avec les hommes, il n'a pas à mon sens cédé particulièrement aux préjugés de son temps sur les femmes. Mais, dans son souci d'efficacité pratique, il a négligé que l'expérience ne permettait pas de conclure à quoi que ce soit définitivement.
- cf. Ethique V, scol. de la prop. 10 ↩
- Traité politique, I, 1. ↩
- TP I, 3 ↩